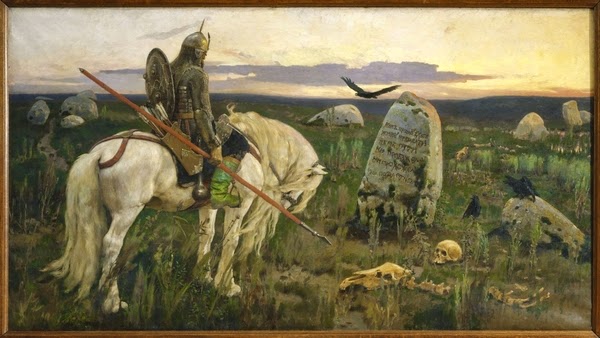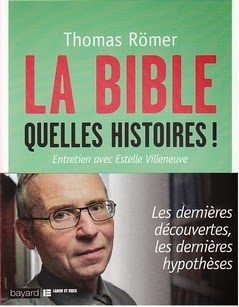Tandis que l'idée d'éternité périclite, commente Benjamin, la
mort cesse d'occuper une place prééminente dans le paysage culturel
de notre temps. L'homme moderne se trouve dès lors privé de tout
horizon, - horizon relativement auquel, et relativement auquel
seulement, la vie a sens ; horizon à l'approche duquel, se
rencontrant ainsi lui-même, le mourant touche à la réalité de son
existence, par là entre dans la forme communicable de cette
dernière, dans le possible de sa propre histoire. C'est la vision
d'un tel possible qui confère au regard du mourant son autorité
insigne. « C'est cette autorité, ajoute Benjamin, qui
est à l'origine du récit ».
Benjamin cite, à titre d'exemple, un récit de Hebel,
intitulé
Retrouvailles inespérées.
La veille de son mariage, un jeune homme trouve la mort au fond des mines de Falun. Sa fiancée lui reste fidèle toute sa vie durant. Un jour, alors qu'elle touche à l'extrême vieillesse, on lui apporte le corps du jeune homme, retrouvé au fond d'un puits et conservé intact par du vitriol ferreux. « La petite vieille reconnaît son fiancé ». Après cette rencontre, elle meurt à son tour.
Ainsi, l'histoire d'amour marche à la rencontre d'elle-même. A la
différence de l'historien, qui explique l'histoire, Hebel se
contente de la raconter. Semblablement aux chroniqueurs du Moyen-Age,
il assigne aux retrouvailles inespérées une fonction qui
fait apparaître ces retrouvailles comme une sorte
d' « échantillon » de ce qui advient dans le
monde, et à ce titre, comme un abrégé de l'histoire du Salut, ou
comme une préfiguration de l'Histoire finie.
Genre ancien, le récit procède du souvenir, sorte de
mémoire dont Benjamin dit qu'elle fonde « la chaîne de
la tradition », qui transmet de génération en génération
les événements passés, tissant ainsi le filet que forment en
définitive toutes les histoires.
«
Car celles-ci se raccordent toutes entre elles, comme
les grands conteurs, particulièrement les Orientaux, se sont plu à
le souligner. En chacun d'eux vit une Schéhérazade, pour qui chaque
épisode d'une histoire en évoque aussitôt une autre. »
Le roman, pense Benjamin, est un genre égoïste.
Le conte, en
revanche, est «
le complice de l'homme libéré ».
Montant et descendant les « échelons de l'expérience
collective », il enseigne les rudiments d'une sagesse pratique
qui, dans la mesure où elle n'exclut « ni la ruse ni
l'effronterie, permet de faire face aux puissances de l'univers
mythique », aux difficultés des travaux et des jours, et à la
mort même, - « pourtant le choc le plus profond de toute
expérience individuelle » -, puisque, considérée à la
lumière de la dite sagesse, « la mort ne représente en
rien un scandale ni une limite. »
"Et s'ils ne sont pas morts, ils vivent
encore aujourd'hui", dit le conte.
Le conteur, écrit Benjamin, doit être mis « au
rang des maîtres et des sages. Car il lui a été donné de remonter
tout le cours d'une vie », faite des expériences qui, par
effet de communion des âmes, sont à la fois les siennes et celles
d'autrui. « Son talent est de raconter sa vie, sa dignité
de la raconter tout entière. »
« Le conteur, c'est l'homme qui pourrait laisser la mèche
de sa vie se consumer entièrement à la douce flamme de ses récits.
Le conteur est la figure sous laquelle le juste se rencontre
lui-même. »
Sources : Walter Benjamin, Le conteur, collection
Folio Essais, Œuvres T3, n° 374
J'ai résumé un article lu dans un blog : « la
Dormeuse »